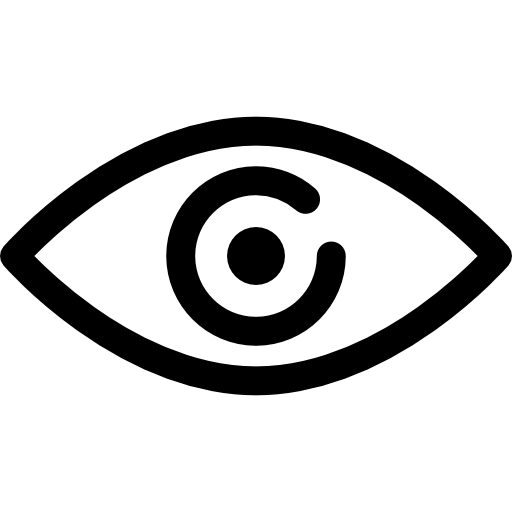Gris-gris par Elisabeth Lebovici, mai 2011
En 1954, Jasper Johns peint le premier tableau de sa série des Flags. La chose se passa d’abord en rêve. « Une nuit, j’ai rêvé que je peignais un grand drapeau Américain, et le lendemain lorsque je me suis levé, je suis sorti acheter les matériaux pour le commencer. Je l’ai fait. » Le rêve se matérialise donc dès le lendemain, l’artiste changeant de matériau en plein milieu du travail, passant de l’émail à la cire parce qu’avec l’encaustique, qui refroidit vite, on n’attend pas le temps du séchage entre chaque intervention, on peut poursuivre la peinture en continu. C’est un tableau très « rotten », très pourri, dit Johns.
Le tableau, Flag, est le drapeau et il n’est pas du tout le drapeau. Il est à la fois cette forme conventionnelle, cette entité de bandes (les colonies originelles) et d’étoiles (le nombre d’États), qui emplit l’intégralité du panneau. Le flag apparaît ici « en personne » à la surface du tableau, non par le biais d’une imitation ou d’une simulation. Lorsqu’on regarde un Flag de Johns, on ne regarde pas l’illusion d’un drapeau, mais le drapeau, la peinture n’ayant pas un rôle subalterne par rapport à la réalité, constituant au contraire la condition de la réalité. Mais on regarde également, intégralement, de la peinture, qui emplit ici de sa présence la totalité de la surface, sans s’abriter derrière le non-réel, la fiction d’une image. La représentation n’est plus un obstacle à la mise en évidence de la spécificité de la peinture, telle que le modernisme la conçoit : entre le drapeau peint de Johns et le drapeau qui volette aux mâts des ambassades, il n’y a rien d’autre que l’épaisseur de la peinture et de son support.
Le tableau, ainsi, se déplie en deux propositions tout aussi logiques l’une que l’autre : le drapeau est le drapeau, la peinture est la peinture. Les deux, pourrait-on dire, sont pris en Flag, dans le flagrant délit du tableau et du regard qu’on lui porte. Peu importe, alors, l’interprétation : les Flags de Jasper Johns peuvent devenir à la fois anti-américains et signe de l’impérialisme pictural des États-Unis. En même temps.
En 2005, Michel Bayetto peint la série des GRay Flags. J’adore le titre. Ce sont aussi des drapeaux. Mais pas d’Amérique. Ils ne représentent pas un État, ni même un conglomérat d’États unis, mais plutôt un état des choses : celui qui accompagne l’homosexualité, affichée depuis une dizaine d’années après Stonewall, sous la bannière d’une bande de couleurs rapprochées. On dit aussi Rainbow Flags, drapeaux arc-en-ciel. Gay Flag, ça fait tout de suite plus pédé, il y a d’ailleurs une association de flics homosexuels qui s’appelle, me semble-t-il, un peu comme ça. Depuis la guerre en Irak, l’arc-en-ciel homosexuel, dans des couleurs toutefois un peu plus blanches et transparentes, a été repris au profit de la Pace, de la paix.
Mais Bayetto ne peint pas de Gay Flag. Il peint des valeurs de gris. Il peint, en réalité, d’après une photocopie noir et blanc d’un drapeau arc-en-ciel également reproduit : une retranscription en densités de gris de ce qui se présente ailleurs comme des changements de couleurs.
Phonétiquement, en passant du Gay Flag au GRay Flag, un r, un air, une ère peut-être, s’immisce. Du drapeau coloré au drapeau gris. Déclaration politique ? Certainement, dans un monde « gay » triste qui va vers l’uniformisation, ou plutôt, qui se concentre sur des images uniformes, celles d’un réformisme gris plutôt que d’une révolution flamboyante. Mais cet « r » introduit une déclaration picturale aussi. En même temps qu’à nos yeux les couleurs se soustraient de l’image conventionnelle, le tableau se construit dans sa polychromie. N’appelait-on pas Grisailles des tableaux aux couleurs de statues ?
Alan Charlton (1988) : « Le gris est ce qu’il y a de plus important dans mes tableaux. Je n’ai jamais fait un tableau qui n’était pas gris. »
Car le gris, en peinture, est l’antithèse d’une soustraction.
Il s’obtient au contraire par addition. Il est la somme, il est toutes les couleurs sans en privilégier une particulièrement. Mélange additif, mélange addictif. Bayetto mixe les trois couleurs primaires. Les teintes, industrielles, normalisées, codifiées, vont, dans cette intervention, littéralement abstraire la couleur, s’effaçant dans l’interaction avec d’autres couleurs pour produire le gris, dans sa monotonie mais aussi dans ses variations qui vont du sombre au clair, du saturé au lumineux. Le gris est le mélange des contrastes. A chaque spectateur revient alors le travail de scruter la nuance et de retrouver la couleur. Le gris n’a à voir qu’avec la couleur.
Dans le même temps, la couleur fait surface et apparaît, comme une mince ligne de vapeur entre deux bandes de gris, ou déposée à l’intérieur d’une bande particulière, comme une rémanence. C’est à ce travail de figuration, de refiguration des couleurs qu’invite la contemplation des tableaux de Bayetto : une contemplation stoïque qui dure, lentement. Infiniment, comme le travail de la peinture.
Le gris est dans la couleur, la couleur est dans le gris et la représentation, dans sa convention, en est toute chamboulée : les couleurs bleue, rouge, jaune, mais aussi verte, orange ou violet ne sont pas « derrière » le gris, ni avant lui : elles ne sont pas des restes, mais des produits du gris, apportés dans le travail de peinture. Tout comme la séparation entre chaque bande, horizontale, réserve des surprises optiques, de clair ou de foncé sur lesquelles le peintre va insister picturalement. Ainsi, la rémanence des couleurs fait ici figure et Bayetto n’hésite pas à en remettre une couche, de rouge, dans un cas, de bleu, dans un autre. Cette recoloration du tableau ne soustrait rien à son abstraction, mais complexifie un peu plus le regard qu’on porte sur elle. Le gris, dirait Hegel, est la couleur de la philosophie.