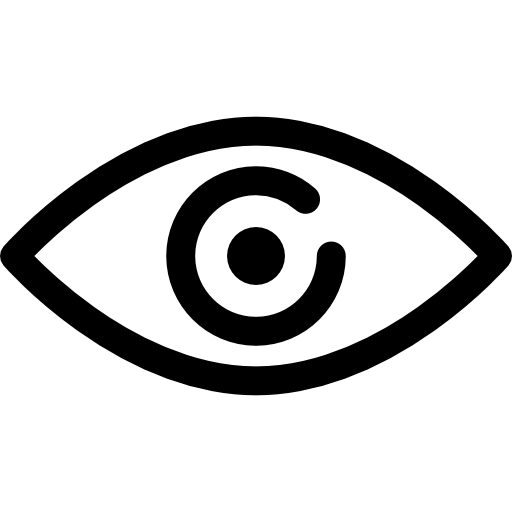Sans issue par Mathieu Riboulet, mars 2016
Sur la série E-Jizz de Bayetto
L’orifice où s’engouffre l’être n’est pas celui qu’on pense. Pas toujours en tout cas. C’est une affaire de détournement du regard.
La pornographie met l’œil là où il ne va pas d’habitude, alors que c’est évidemment là qu’il meurt d’envie d’aller. Et plus il y va, plus il est déçu, et plus il est déçu, plus il a envie d’y aller encore.
Dans la masse pornographique que nous avons produite, inépuisable, et nous inépuisés, il y a ces hommes dont la psyché pédé raffole, qu’elle traque, qu’elle vampirise. Ils sont là devant nous, ce sont souvent de grandes masses de chair, de chair que l’on veut dure, que l’on a dure, déployées avec faste, somptueuses et veloutées.
C’est cela qu’on veut voir, ce déploiement de chair, cet éventail qui va, en échancrant chemise, ceinture de pantalon, en déroulant les cuisses, nous saisir à la gorge, nous laisser chancelants.
C’est cela que nous voulons, chanceler d’émotion de tant de chair conquise, espérer de nouveau atteindre à l’effacement, saisir le point précis où tout va disparaître. L’orifice. Non celui qui rejette, délivre ou évacue, celui où l’on voudrait se glisser pour toujours.
Alors nous le faisons, nous faisons cela, nous allons voir. Et dans la fièvre de l’inassouvissement nous voyons, et nous cherchons encore, et de nouveau nous voyons, et nous cherchons et voyons si bien, et tant, et de tant de manières qu’à la fin nous voici, trempés parfois, toujours inassouvis et bien souvent aveugles.
Il nous est difficile de dire que nous n’avons rien vu quand nos yeux se sont emplis de monts et de merveilles, quand nos pupilles se sont affolées d’avoir à refléter si grand nombre de torses miroitants, de cuisses généreuses, de sexes contondants.
Mais nous n’avons rien vu, pourtant, car notre regard s’est perdu. S’est-il dissous, brisé, a-t-il perdu son âme ? Ou, renvoyé à lui-même, n’a-t-il d’autre chemin à emprunter que celui qui ne le renvoie qu’à lui-même : non plus voir pour connaître, aimer, trembler ou avant de toucher, mais voir pour voir ?
Ce n’est plus, alors, dans le trop-plein des cuisses, l’imperfection, charmante, d’un torse qui se penche, dans la clarté soudaine d’une queue qui s’empoigne que nous nous égarons, mais dans l’impossible assouvissement de ce qui tend le regard, le bande comme un arc d’autant plus saturé de force et de tension qu’il a perdu sa cible.
L’orifice où nous finirons par disparaître aura peut-être l’opacité de l’étang, peut-être finirons-nous par y voir quelque chose, un très bref instant, après n’avoir rien vu tout au long de nos jours. Peut-être alors le flou, le cercle parfois opaque et parfois pâle que la peinture, ici, appose sur les visages pour en marquer l’absence, se délitera-t-il dans les ombres dansantes et pourrons-nous saisir, non plus seulement ces membres, aussi somptueux soient-ils bien qu’épars, dérobés, toujours à regagner, mais un tout unifié par un regard humain, quelque chose comme un corps.